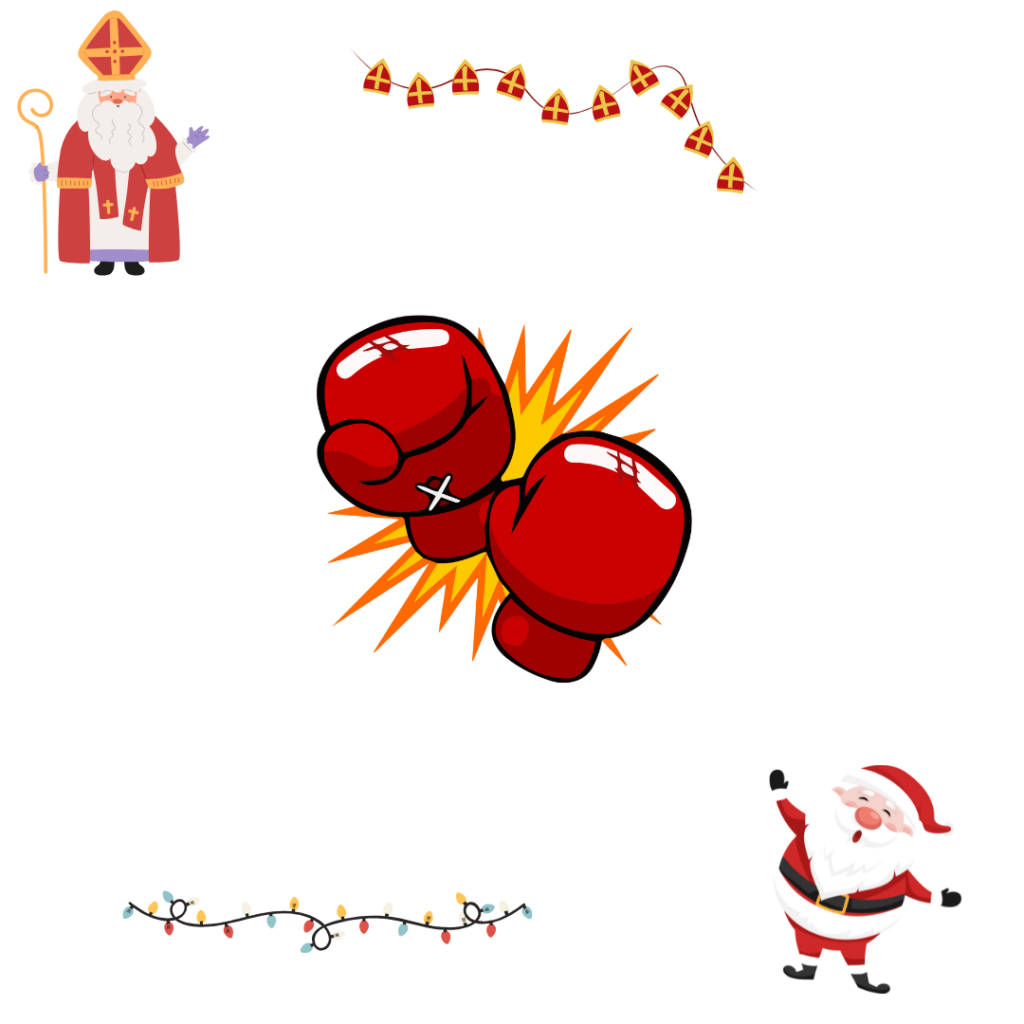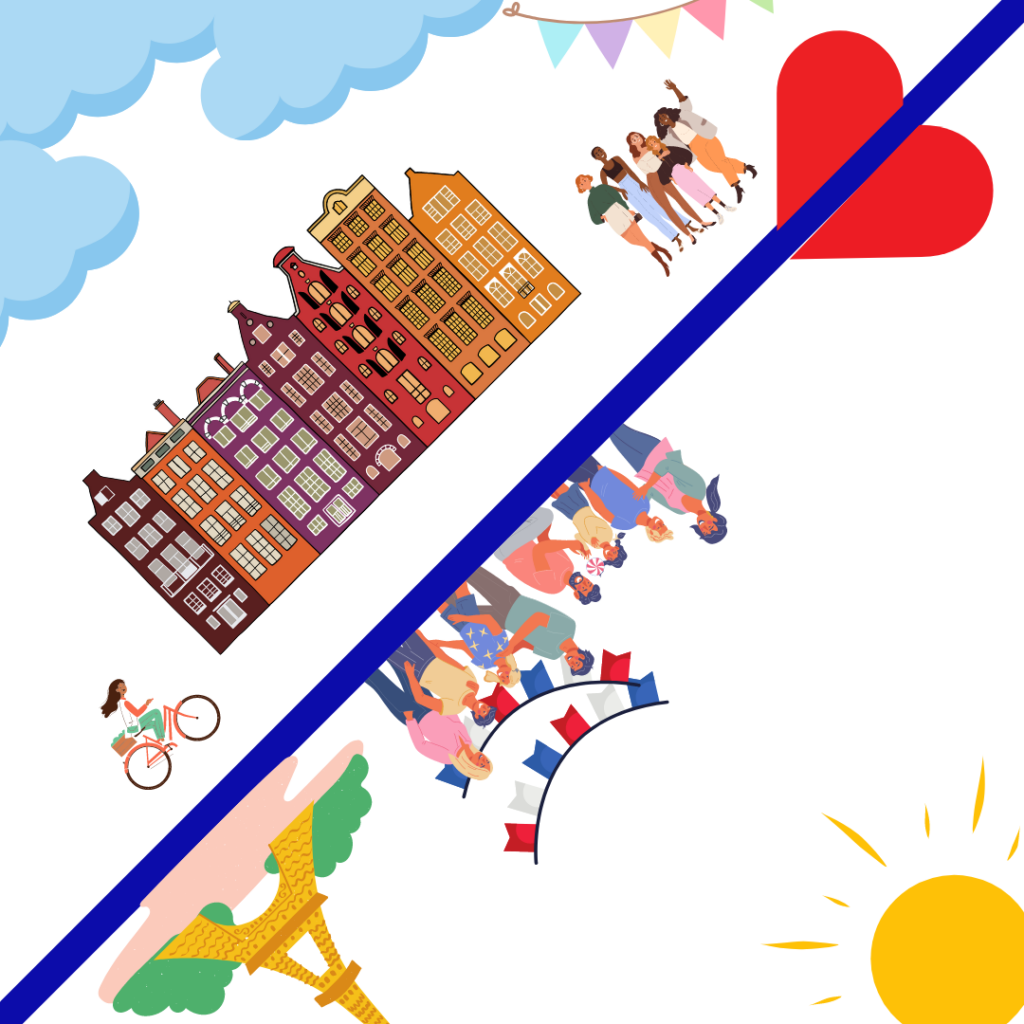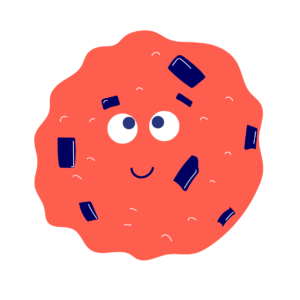Rencontre avec Céline Devaux
Avec Tout le monde aime Jeanne, Céline Devaux nous offre un long métrage hors du commun qui dénonce les répercussions du regard de l’autre sur nous-mêmes, où l’on s’interroge sur des sujets de société traités sous un prisme inédit, le tout rythmé par un humour caustique. Avec cette rencontre exceptionnelle, Francine vous invite à découvrir, sans rien dévoiler de son intrigue, les grands thèmes de ce film, qui est présenté au festival Tapis Rouge, et à vous pencher sur le parcours singulier de sa réalisatrice, pour mieux appréhender son approche esthétique audacieuse.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Céline Devaux, j’ai trente-cinq ans et je suis la réalisatrice de Tout le monde aime Jeanne, mon premier long métrage. J’ai fait des études de littérature puis, j’ai intégré l’École nationale des arts décoratifs de Paris. J’ai commencé par faire des courts métrages d’animation, (NDLR : son projet de fin d’études Vie et mort de l’illustre Grigori Efimovitch Raspoutine a reçu de nombreuses récompenses et Le Repas Dominical obtient un César en 2016) puis un court métrage, Gros chagrin, qui mélangeait les deux médias.
Comment êtes-vous passé des Arts Décoratifs au cinéma ?
l’École nationale des arts décoratifs de Paris propose une spécialisation cinéma d’animation. Très vite, j’ai eu envie de m’intéresser à ce médium, j’ai eu envie de faire du cinéma. Ne pas venir d’une école de cinéma est inhabituel, mais j’ai pu observer qu’être un outsider, c’est utile quand on cherche à montrer des choses différentes.
Pouvez-vous nous parler de tout le monde aime Jeanne ?
Tout le monde aime Jeanne, c’est une comédie de la dépression. Ce film parle de l’échec, de la honte, de la peur, mais il le fait en tirant le comique du tragique. Ce qui est je pense, assez proche de ce qui se passe dans la vie.
C’est l’histoire de Jeanne (Blanche Gardin), championne écologique contemporaine. Cette femme au métier irréprochable vit une humiliation publique énorme en ratant l’inauguration de son projet de sauvetage des océans. À partir de là, nous la suivons, sans le sou et sans perspective, alors qu’elle doit retourner à Lisbonne vendre un appartement familial. Sur le chemin, elle va rencontrer Jean (Laurent Lafitte), qui est un type un peu bizarre. Il soutient qu’ils sont allés au Lycée ensemble et que tout le monde était amoureux d‘elle. Il va lui coller aux basques pendant tout le film…
À quel moment, durant le processus de création de Tout le monde aime Jeanne, l’animation s’est-elle imposée dans le film ?
J’écris en dessinant. L’idée du dessin s’impose assez vite dans tout ce que je fais. Au début, j’avais juste l’idée de raconter l’histoire d’une femme un peu perdue. Ensuite, j’ai réalisé que ce que je voulais, c’était parler de la honte. Et pour parler de ce sentiment, je trouvais intéressant de rendre visuel l’intériorité de la personne qui le ressent. J’aurais pu m’arrêter à la voix off car, finalement, ce sont toutes ces voix dans nos têtes (peurs, souvenirs, autocritiques…) qui nous rappellent nos angoisses. Mais je trouvais que les incarner avec ce « petit fantôme », ce personnage chevelu-diabolique, donnait une nouvelle perspective.
La représentation de ce « petit fantôme » est-elle une piste d’exploration personnelle ?
L’idée du petit fantôme est inspirée d’une BD que je dessine en secret et qui retrace mes histoires humiliantes. J’ai tiré le fil de quelque chose qui me suit depuis longtemps. Néanmoins, l’illustration du « petit fantôme » a été inventée pour ce film.
Il y a un contraste immense entre ce que pense Jeanne via ce « petit fantôme » et ce qu’elle dit. Pensez-vous que nous puissions rester nous-mêmes au contact des autres ?
C’est un film qui parle de perception. Quand Jeanne rencontre Jean, c’est son apriori qui parle (et le nôtre) : Jean est un gros lourd. Par principe, l’homme qui vient nous parler alors qu’on n’en a pas envie, c’est un lourdaud. Pourtant, Jean ne dit que des choses gentilles. C’était aussi l’occasion de montrer la complexité de la perception.
Jeanne, elle, reste polie en apparence, mais elle n’est pas elle-même. Elle est alourdie par cette obligation d’être polie, mais également par la mauvaise image qu’elle a d’elle-même. Comme beaucoup d’entre nous, elle est constamment en représentation. Quand elle réussit, elle porte une énorme responsabilité sur ses épaules et, quand elle échoue, elle a une position morale très lourde à porter. Elle a du mal à dire la vérité, à être honnête. C’est trop dur.
Pourquoi avoir choisi Lisbonne pour planter le décor du film ?
C’est une ville que je connais bien. La première fois que j’y ai séjourné, c’était en 2013. J’ai pu y voir les conséquences de la crise économique de 2011. En France, l’austérité était présente bien sûr, mais sans les conséquences immédiatement matérielles que subissaient les Portugais. Eux étaient amputés de 30 % de leur salaire, virés de leurs appartements… À cette époque, les Français (et les autres ressortissants étrangers) pouvaient s’installer au Portugal et ne payaient d’impôts ni dans leur pays d’origine ni dans leur pays de résidence. L’idée derrière cette loi, maintenant révolue, était de booster l’économie portugaise. Mais les prix de l’immobilier ont augmenté très rapidement et ont forcé des milliers de Portugais à déménager.
Je suis de cette génération qui a été bercée par l’illusion européenne de la démocratisation des voyages par les compagnies aériennes low cost et l’émergence d’Airbnb. On avait le sentiment de pouvoir aller d’un pays à un autre comme si on prenait le métro… On vivait dans l’appartement de quelqu’un qu’on ne connaissait pas, on prenait des photos et on revenait en racontant ce qu’on avait vu. On n’était pas dans l’échange. En vérité, cela s’est transformé en une destruction spéculative et esthétique. Soudainement les villes étaient des images et les images appartenaient à tout le monde.
Par ailleurs, à Lisbonne les couleurs sont partout, la mer scintille au loin… J’ai le sentiment que lorsqu’on n’arrive pas à voir la beauté d’un endroit (comme c’est le cas pour notre protagoniste), c’est la confirmation qu’on ne va pas bien. Quand on est heureux et en bonne santé, à l’inverse, on voit la beauté partout.
En comparaison, quelle image avez-vous d’Amsterdam ?
C’est une ville d’action avec une lumière très particulière qui permet cette circulation entre extérieur et intérieur, une sorte de nappe dorée même en hiver.
Comment voyez-vous le fait de vivre à l’étranger ?
J’ai grandi dans un milieu expatrié en Allemagne et en Suisse. Je trouve que c’est un milieu très compliqué où l’on trouve beaucoup de certitudes et de renfermement, mais également une mixité sociale intéressante.
J’ai beaucoup de souvenirs “d’entre soi”. Cela vient probablement du fait que l’on n’est pas dans un système de voyages, mais de ports d’attache. On restait un an ou deux avant de repartir ailleurs. De ce fait, on s’accrochait aux autres Français comme une moule à son rocher. En revanche, des personnes issues de milieux sociaux différents, qui ne se parleraient probablement pas en France, sont amies à l’étranger. Évidemment il s’agit majoritairement de milieux très aisés. D’ailleurs, on parle bien d’« expatriés » et non d’ «immigrés »pour marquer une différence.

La sensibilité et l’anxiété que l’on peut ressentir dans des moments de vulnérabilité sont particulièrement bien représentéEs dans votre film. L’agression des cinq sens par le monde extérieur est presque tangible et pourtant subtilement amenée.
Merci. Je pense que le ressenti des individus dits « angoissés » est très intéressant. Ils voient, vivent, ressentent en haute définition et peuvent le transmettre à d’autres qui n’en ont pas conscience. Ils sont pafois en mesure de trouver les mots ou les vecteurs poétiques d’une certaine conscience du monde.
Je vous invite à observer le travail de Marion Fayolle qui fait des illustrations qui en sont un exemple particulièrement parlant. Elle crée des métaphores d’une élégance folle.
Pensez-vous que la maladie mentale et le suicide sont encore des sujets tabous ?
De moins en moins. D’ailleurs, on assiste en ce moment à une vulgarisation des termes concernant la maladie mentale sur les réseaux sociaux. Le fait qu’on ait libéré la parole à ce sujet invite beaucoup de gens à s’auto-définir par des termes pathologiques, HPI, hypersensible.
Par ailleurs, aller mal n’appelle pas, selon moi à une conversation. Quand on est déprimé, il n’y a pas de solution que l’interlocuteur en face puisse apporter, à moins qu’il ne soit thérapeute. Il n’a pas à se rendre utile, juste à écouter. Ce qui est très difficile. L’humain a du mal à ne pas être dans l’action. Dans le film, seul Jean ne ressent pas le besoin d’être actif. Il est dans une sorte de résignation pacifique. Dans notre société, l’anxiété et la dépression sont difficiles à appréhender, car les personnes touchées par ces maux ne sont plus dans l’action. Ils ne sont plus « utiles ».
Avez-vous une opinion concernant la place des femmes dans le cinéma que vous souhaitez partager ?
Dans le cinéma français, on peut noter que l’on est assez bien loti avec 40 % de premiers films réalisés ou co-réalisés par des femmes. En France, nous avons des figures tutélaires de cinéastes femmes depuis longtemps et cela continue de croître. Ma productrice, Sylvie Pialat, pour ne citer qu’elle, ne manque pas de puissance. C’est d’ailleurs, grâce à elle, que Tout le monde aime Jeanne a pu se faire.
Mais selon moi, la place des femmes au cinéma se joue aussi et surtout au niveau de la représentation dans la fiction. L’homme hétéro blanc est présent dans tous les corps de métier du cinéma français depuis toujours, mais il a également pu jouer tous les spectres de l’homme dans la fiction. Tous les petits garçons blancs de ma génération ont pu s’identifier à un panel de personnages incroyables. Alors que nous, les petites filles, nous n’avions que peu de choix. Aujourd’hui, il est essentiel d’accorder aux femmes la possibilité d’être présentes dans tous les rôles. Il faut des femmes, cruelles, drôles, pas drôles, méchantes, etc.
Selon vous, l’usage des quotas est-il pertinent ou faut-il laisser faire les choses « naturellement » ?
Les quotas sont déjà là. Mais il y a une différence entre la mise en place de mesures et les comportements quotidiens qui vont mettre beaucoup de temps à changer…